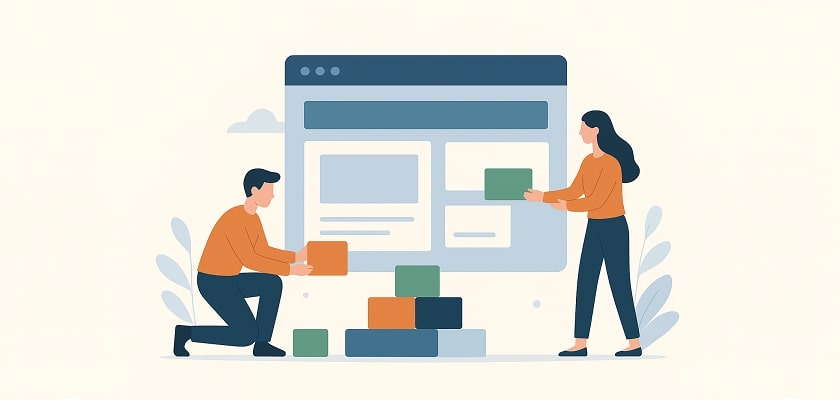Aujourd’hui, un site qui ne prend pas en compte les différents profils de ses visiteurs, notamment ceux en situation de handicap, risque de laisser de côté une partie de son audience. Une manière efficace d’éviter ça est de concevoir son site avec une approche ascendante (bottom-up).
Le site Smashing Magazine a publié en octobre 2024 un article détaillé sur l’approche ascendante dans le design web et son impact sur l’accessibilité. Voici l’essentiel à retenir.
C’est quoi une approche bottom-up ?
La plupart du temps, les sites sont pensés de manière « top-down » (ou descendante) : on imagine d’abord le concept global, puis on le découpe en parties plus petites. L’approche « bottom-up » fait l’inverse : on part des détails les plus précis, et on construit progressivement une vision d’ensemble.
Cette façon de penser est d’ailleurs fréquente chez les personnes neuroatypiques. Là où les personnes dites « neurotypiques » réfléchissent souvent en partant du global, les personnes autistes ou avec un TDAH ont tendance à fonctionner de manière plus ascendante.
Les chercheurs distinguent d’ailleurs plusieurs types de pensée chez les personnes autistes :
- Les penseurs visuels, qui raisonnent en images
- Les penseurs par schémas, qui voient les liens et les structures
- Les penseurs verbaux, qui raisonnent uniquement en mots
Ces profils montrent une préférence pour le raisonnement « bottom-up », ce qui n’est pas toujours pris en compte dans les conceptions classiques.
Un bon exemple est celui de la rédaction d’un essai.
Avec une approche descendante, on définit d’abord une idée principale, puis on rédige un plan, avant d’écrire chaque partie.
Avec une approche ascendante, on note d’abord toutes les idées au fil de l’inspiration, même désordonnées, puis on les regroupe et on les organise en un plan cohérent. On part du détail pour arriver à une vision globale.
C’est la même logique en web design.
On peut commencer par créer la mise en page d’un seul article, puis réfléchir à comment il s’intègre avec les autres pages, et ainsi construire peu à peu des catégories cohérentes.
On peut aussi aller plus loin dans les détails : par exemple, placer un menu tout en bas d’un site mobile pour qu’il soit plus facile à atteindre avec le pouce, puis concevoir un menu déroulant adapté à ce positionnement. Ce choix initial influence ensuite l’organisation générale du site.
Dans tous les cas, cette méthode consiste à identifier les petits obstacles que les utilisateurs pourraient rencontrer, et à les corriger un par un, avant de penser au « grand design ».
Lire Aussi : 10 plugins d’accessibilité WordPress pour rendre votre site inclusif
Pourquoi l’approche « bottom-up » favorise l’accessibilité
Même si les deux approches (descendante et ascendante) coexistent dans le secteur, de nombreux concepteurs privilégient le « bottom-up » pour ses bénéfices en matière d’accessibilité.
Mettre les besoins des utilisateurs en premier
Le grand avantage de cette méthode est qu’elle part des besoins réels des utilisateurs. Les approches descendantes paraissent ordonnées, mais elles reflètent souvent davantage les préférences du concepteur que celles du public.
Les réseaux sociaux en sont un bon exemple.
Sur Facebook, le fil d’actualité se recharge automatiquement, ce qui fait perdre le contenu qu’on était en train de lire.
Sur TikTok, l’historique de visionnage est longtemps resté difficile à trouver sans chercher un tutoriel externe.
Ces choix peuvent sembler logiques sur le papier, mais ils nuisent à l’expérience des utilisateurs.
Et ce problème est loin d’être rare : près de 96 % des grandes pages d’accueil contiennent des erreurs d’accessibilité (selon les directives WCAG).
L’approche ascendante réduit ce risque, car elle incite à rester attentif aux petits détails que l’on aurait pu ignorer.
Intégrer l’accessibilité dès le départ
Un autre problème de l’approche descendante est qu’elle oblige souvent à ajouter l’accessibilité après coup.
Et cela peut vite tourner au casse-tête.
Imaginons un site créé par une administration locale.
Il regorge d’images haute résolution, de couleurs vives et de graphiques interactifs. Mais ensuite, on se rend compte que :
- les images ne sont pas lisibles par les lecteurs d’écran,
- les sous-menus compliquent la navigation au clavier,
- les couleurs vives gênent la lecture des personnes malvoyantes.
Pour corriger ça, on ajoute des légendes aux images, on tente de changer les couleurs… mais cela perturbe tout le design initial et l’ergonomie du site.
Ce genre de modifications forcées entraîne souvent des bugs, des liens cassés ou une baisse massive de trafic.
Alors qu’avec une approche « bottom-up », on pense à ces contraintes dès le début, ce qui évite de tout reconstruire après coup.
Développer une meilleure sensibilité aux besoins des utilisateurs
L’approche « bottom-up » permet aussi de repérer plus facilement les problèmes d’accessibilité.
Quand on commence par la vision globale d’un site, on passe souvent à côté de détails pourtant essentiels.
À l’inverse, en partant des éléments concrets, on identifie plus tôt les obstacles et on peut les corriger avant qu’ils deviennent bloquants.
Cette vigilance est important pour toucher un public varié.
Environ 16 % de la population mondiale — soit 1,3 milliard de personnes — vivent avec un handicap. Ces utilisateurs ont des besoins très différents, que beaucoup de concepteurs ignorent faute d’en avoir fait l’expérience eux-mêmes.
C’est ce décalage qui fait que certains détails leur échappent, alors qu’ils impactent fortement l’expérience de navigation.
Penser d’abord à la manière dont chacun pourra utiliser votre site permet de combler ce fossé.
Lire Aussi : Comment rendre votre site WordPress accessible à tous ?
Bottom-up ou top-down : quelle approche choisir
L’approche ascendante apporte de vrais atouts en matière d’accessibilité. Mais cela ne signifie pas que l’approche descendante n’a aucun intérêt. Tout dépend de vos objectifs et de votre manière de travailler.
L’approche top-down aide à garder une image de marque cohérente. On part d’une idée globale qui sert de fil conducteur pour toutes les décisions à venir. C’est pratique pour maintenir une hiérarchie claire dans une équipe et pour avancer plus vite.
L’approche bottom-up est plus pertinente quand l’accessibilité pour un public très divers est votre priorité. Elle demande plus de temps et de rigueur, mais elle favorise un site plus fonctionnel et plus inclusif. Le revers, c’est que les cycles de conception sont souvent plus longs et donc parfois plus coûteux.
Au final, le choix dépend aussi du mode de travail de votre équipe.
Certains préfèrent une méthode descendante, d’autres se sentent plus à l’aise avec une logique ascendante.
Combiner les deux est souvent une bonne idée : partir d’un cadre global, puis peaufiner chaque élément en suivant une démarche bottom-up.
Comment mettre en place une approche « bottom-up »
Si vous décidez d’adopter cette méthode, voici quelques bonnes pratiques pour la mettre en place efficacement.
Écouter vos utilisateurs actuels
Le cœur d’une conception ascendante, c’est l’utilisateur. Votre base d’utilisateurs existante est donc le meilleur point de départ.
Interrogez vos visiteurs et vos clients sur leur expérience : ce qui leur pose problème, ce qu’ils aimeraient voir amélioré, les fonctionnalités qu’ils apprécient.
Repérez les points communs dans leurs réponses et construisez votre site autour de ces besoins réels.
Les normes d’accessibilité du W3C (WCAG) peuvent aussi vous inspirer, mais les retours concrets des utilisateurs doivent rester votre priorité.
Lire Aussi : Mode sombre : est-ce vraiment meilleur pour l’expérience utilisateur ?
Analyser vos anciens projets
Vos anciens sites peuvent également vous aider à identifier les lacunes en accessibilité. Relisez les anciens retours clients, parcourez les historiques de mises à jour et testez vous-même ces sites.
Repérez les obstacles, notez tout ce qui gêne la navigation et ce qui devra être corrigé dans vos prochains projets.
Documentez tout ce que vous trouvez. Cela facilitera vos futurs efforts d’optimisation.
Répartir les tâches tout en gardant le contact
Une approche bottom-up prend plus de temps. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les méthodes descendantes sont populaires : elles sont rapides.
Pour rester efficaces, répartissez les tâches entre plusieurs petites équipes. Mais il est très important qu’elles communiquent très souvent pour que tout reste cohérent.
Une organisation de type DevOps peut être utile. Elle favorise à la fois le travail détaillé en petits groupes et des points réguliers en équipe complète. Cela permet d’avancer vite tout en gardant une vision d’ensemble cohérente, ce qui est essentiel dans une approche ascendante.
L’accessibilité est devenue incontournable dans la conception de sites Internet. Et une approche bottom-up peut vraiment aider à bâtir des plateformes plus inclusives et mieux adaptées à tous. Elle permet de répondre à une plus grande diversité de besoins tout en rendant le web plus équitable.