Se lancer dans le e-commerce peut vraiment transformer une activité. Avec une boutique en ligne, on peut vendre ses produits ou ses services 24h/24, toucher une clientèle beaucoup plus large qu’en local, et développer sa visibilité sans forcément investir dans un point de vente physique.
Mais attention, vendre en ligne ne se résume pas à créer un site web. En France, le commerce électronique est encadré par des règles très strictes. Et tout entrepreneur qui se lance doit s’assurer de respecter ces obligations sous peine de sanctions.
Voici ce que tout e-commerçant doit savoir avant de se lancer, selon entreprendre.service-public.fr (Le site officiel d’information administrative pour les entreprises).
Quels types d’activités sont concernés par le e-commerce ?
Presque toutes les activités peuvent être exercées en ligne. On peut vendre des produits, neufs ou d’occasion, ou proposer des services comme la restauration, le transport, l’hébergement ou les loisirs.
Cependant, certains produits sont soumis à des règles spécifiques. Voici les principales exceptions à retenir :
| Produit | Conditions de vente en ligne |
| Alcool | – Vente autorisée, mais encadrée – • Licence spécifique obligatoire + formation • Mention interdisant la vente aux mineurs • Interdiction de contenu incitant les mineurs à consommer |
| Médicaments sur ordonnance | – Vente très réglementée – • Réservée aux pharmacies physiques ouvertes au public • Autorisation de l’ARS requise • Information à l’Ordre des pharmaciens • Vente de médicaments sans ordonnance autorisée sous conditions |
| Tabac | – Vente en ligne interdite– |
Lire Aussi : Comment savoir si un site fait du dropshipping ?
Les mentions légales

Tout site de vente en ligne doit indiquer clairement qui est derrière. Ces informations doivent être faciles à trouver. Elles peuvent être dans les conditions générales de vente ou sur une page dédiée.
Il faut indiquer :
- le nom de l’entreprise, sa forme juridique, son adresse, et son capital
- le nom et l’adresse de la personne responsable si c’est une entreprise individuelle
- le numéro Siren ou RCS
- une adresse mail et un numéro de téléphone
- le numéro de TVA
- le nom, l’adresse et le téléphone de l’hébergeur du site
- l’autorité ayant délivré une autorisation si l’activité est réglementée (comme une pharmacie ou un débit de boissons)
Ne pas afficher ces informations peut être lourd de conséquences. Une entreprise individuelle risque jusqu’à un an de prison et 75 000 euros d’amende. Pour une société, l’amende peut atteindre 375 000 euros.
Les conditions générales de vente
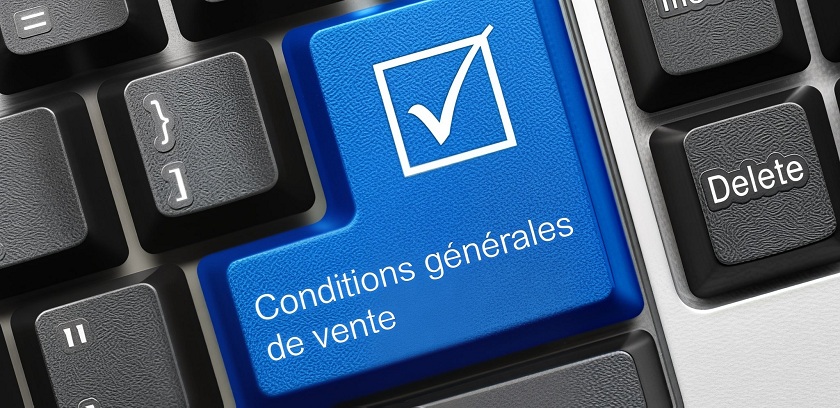
Les conditions générales de vente, ou CGV, servent à poser un cadre clair entre vous et vos clients. Elles précisent ce que chacun peut attendre de la transaction, ce qui réduit les malentendus et les litiges.
Ces informations doivent être claires, faciles à lire, et accessibles depuis votre site. Leur contenu varie selon que vous vendez à des particuliers ou à des professionnels.
Si vous vendez à des particuliers
Les CGV sont obligatoires. Elles doivent apparaître sur votre site internet.
En cas d’oubli, l’entreprise individuelle risque une amende de 3 000 euros. Pour une société, cela monte à 15 000 euros.
Voici ce que vos CGV doivent contenir :
- une description claire des produits ou services proposés
- les prix, toutes taxes comprises, en euros
- les frais, les délais et les modalités de livraison
- les conditions d’exécution du contrat
- les moyens de paiement acceptés et les règles en cas de retard
- les conditions de rétractation (délai, modalités de retour)
- les garanties légales (conformité et vices cachés)
- les garanties commerciales et le service après-vente, avec le coût éventuel des communications
- la durée du contrat et les conditions de résiliation si cela s’applique
- la caution ou les garanties demandées au client, si c’est le cas
- la durée minimale des engagements du client, le cas échéant
- l’existence d’un éventuel code de conduite
- l’identifiant unique (IDU) si votre entreprise est soumise à la responsabilité élargie du producteur
- les modalités de règlement des litiges (tribunal compétent, recours possible à un médiateur)
Vous devez aussi proposer un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges.
Si vous vendez à des professionnels
Les CGV ne sont pas obligatoires, mais vous devez pouvoir les fournir à tout moment, si on vous les demande.
Refuser de les communiquer peut vous coûter cher : jusqu’à 15 000 euros d’amende pour une entreprise individuelle, et 75 000 euros pour une société.
Voici ce que vous devez y faire figurer :
- les prix hors taxes, ou bien la méthode utilisée pour les calculer
- les remises possibles (rabais, ristournes, promotions ponctuelles), avec des critères clairs
- les escomptes commerciaux en cas de paiement anticipé
- les modalités de paiement, ainsi que les pénalités en cas de retard
- les frais et délais de livraison
- le tribunal compétent en cas de litige
Il est aussi possible d’y ajouter d’autres clauses, comme la réserve de propriété, la limitation de responsabilité, les cas de force majeure ou encore les conditions de résiliation.
À savoir : vous pouvez créer des CGV différentes selon vos types de clients (grossistes, détaillants, etc.). Dans ce cas, chacun n’a accès qu’aux CGV qui le concernent.
Lire Aussi : UX et conversions : les bonnes pratiques pour un site plus efficace
Les données personnelles

Quand on vend en ligne, on collecte des informations sur les visiteurs. Cela fait partie du jeu. Mais cela impose aussi des règles strictes.
Nom, prénom, adresse mail, localisation, photo ou même adresse IP… tout cela entre dans la catégorie des données personnelles. Dès lors qu’il est possible d’identifier une personne, directement ou non, vous devez respecter la loi.
Deux choses sont obligatoires : informer l’internaute et obtenir son consentement dans certains cas.
1. Informer l’internaute
Tout doit être clair dès le départ. Si vous demandez des données à un utilisateur, par exemple via un formulaire de contact, vous devez l’en informer tout de suite. Et si vous changez plus tard la manière dont ces données sont utilisées, il doit aussi en être informé.
Voici les éléments que vous devez préciser :
- qui est responsable de la gestion des données (par exemple un délégué à la protection des données)
- pourquoi vous collectez ces données
- sur quelle base juridique vous vous appuyez (consentement, contrat, obligation légale…)
- si les données sont obligatoires ou non, et ce que cela implique s’il ne les fournit pas
- qui pourra accéder à ces données
- combien de temps vous les garderez
- quels sont les droits de l’internaute (accès, modification, suppression, refus de collecte)
- la possibilité de faire une réclamation auprès de la CNIL
- si les données sont transférées hors de l’Union européenne
L’information doit être courte, claire et facile à comprendre. Pas de jargon inutile.
Toutes ces infos doivent être accessibles depuis n’importe quelle page du site. Il suffit d’ajouter un lien visible, intitulé par exemple « Données personnelles » ou « Confidentialité ». Ce lien ne doit pas être noyé dans les conditions générales de vente ou d’utilisation. Il doit mener à une page dédiée à la politique de confidentialité.
Ne pas informer les utilisateurs comme il se doit peut entraîner une amende de 1 500 euros.
2. Obtenir le consentement
Dans certains cas, il ne suffit pas d’informer l’internaute. Il faut aussi qu’il donne son accord.
C’est le cas par exemple si vous :
- envoyez une newsletter. Vous devez obtenir l’accord clair de la personne, sauf si elle a déjà acheté un produit similaire chez vous ou si c’est un professionnel. Il faut aussi permettre à tout moment de se désinscrire.
- utilisez des cookies pour suivre la navigation ou afficher des pubs ciblées. Le visiteur doit pouvoir dire oui ou non, facilement.
Le consentement doit être explicite. Une case à cocher, oui. Une case déjà cochée, non. Et si la personne ne fait rien, c’est non aussi. Continuer à naviguer ne veut pas dire qu’elle est d’accord.
Il faut aussi proposer un choix par finalité. L’utilisateur doit pouvoir accepter certaines choses et en refuser d’autres. Par exemple : accepter les cookies pour l’analyse, mais refuser ceux pour la pub. Vous pouvez ajouter des boutons « Tout accepter » ou « Tout refuser », à condition d’avoir bien expliqué chaque finalité en amont.
Collecter des données sans consentement peut vous coûter cher. L’amende peut monter à 300 000 euros. Et la sanction peut aller jusqu’à 5 ans de prison.
Contrat de vente, livraison et paiement

Sur un site e-commerce, la vente entre un professionnel et un particulier suit des règles précises. Le client et le vendeur ne sont pas face à face, donc tout doit être clair, transparent et conforme à la loi.
Avant de valider la commande
Quand un client remplit son panier, vous devez lui fournir plusieurs informations importantes :
- le prix et les caractéristiques essentielles des produits ou services
- en cas d’abonnement, la durée du contrat et la durée d’engagement
- les étapes à suivre pour finaliser la commande
- les moyens pour vérifier et corriger d’éventuelles erreurs avant la validation (comme l’accès à un récapitulatif du panier)
- les langues disponibles pour passer la commande
- les conditions d’archivage du contrat si le montant atteint ou dépasse 120 euros
- les règles professionnelles auxquelles vous vous engagez
Lire Aussi : Comment lancer un programme d’affiliation pour son e-commerce
La validation finale
Une commande ne peut pas être validée en un seul clic. Trois étapes sont obligatoires :
- un récapitulatif complet avec le prix total
- la possibilité de modifier la commande
- une confirmation finale
Le client doit aussi être clairement informé qu’il s’engage à payer. Le bouton de validation doit mentionner sans ambiguïté une formule comme « Commande avec obligation de paiement ».
Une fois la commande passée, vous devez envoyer un accusé de réception sans attendre. Cela peut se faire par mail ou via une page imprimable accessible sur le site. Cet accusé, la commande et sa confirmation doivent être accessibles par les deux parties.
Livraison
Le client doit connaître le délai précis de livraison ou d’exécution du service avant de valider sa commande.
S’il n’y a pas de date annoncée, la livraison doit avoir lieu dans les 30 jours maximum.
En cas de retard, le client peut annuler sa commande et demander un remboursement. Vous avez alors 14 jours pour le rembourser. Vous ne pouvez pas lui imposer un avoir ou un bon d’achat.
Moyens de paiement
Le paiement peut se faire au moment de la commande ou à la livraison.
Vous pouvez proposer plusieurs options :
- carte bancaire (nécessite un contrat de vente à distance avec votre banque)
- virement bancaire
- portefeuille électronique comme PayPal ou Paylib
- paiement via la facture mobile ou internet (montant ajouté à la facture télécom)
- chèque ou espèces si le paiement est fait à la livraison
Vous ne pouvez pas facturer de frais supplémentaires en fonction du mode de paiement choisi par le client.
Le droit de rétractation du client

Quand un consommateur achète sur votre site, il a le droit de changer d’avis. Il dispose de 14 jours pour annuler sa commande, sans avoir à se justifier et sans frais, sauf ceux liés au retour du produit.
Ce droit s’applique aussi bien aux produits neufs qu’aux articles soldés ou d’occasion.
Le délai commence le lendemain de la réception du produit. Pour un service, il débute le lendemain de la signature du contrat.
Vous devez informer clairement vos clients de ce droit. Vous devez indiquer le délai, les conditions, et préciser si les frais de retour sont à leur charge. Il est aussi obligatoire de leur proposer un formulaire de rétractation.
Une fois informé de la rétractation, vous avez 14 jours pour rembourser la totalité des sommes versées.
Le droit de rétractation s’applique une seule fois. Si un contrat est reconduit automatiquement ou passe d’une version gratuite à une version payante, le client ne bénéficie pas à nouveau de ce droit.
Les cas où le droit de rétractation ne s’applique pas
Certains produits ou services ne peuvent pas être retournés. Par exemple :
- un article personnalisé ou fabriqué sur demande
- un produit périssable (comme des aliments)
- un CD, DVD ou logiciel descellé
- un produit ouvert pour des raisons d’hygiène (comme des cosmétiques ou des sous-vêtements)
- un journal, un magazine ou un périodique (hors abonnements)
- une prestation liée à une date précise : hébergement, transport, location, restauration, loisir
- un service exécuté avant la fin du délai, si le client a donné son accord pour y renoncer
Ne pas informer le client de son droit de rétractation est puni d’une amende de 15 000 € pour un entrepreneur individuel, et de 75 000 € pour une société.
Résiliation d’un abonnement en ligne

Depuis le 1er juin 2023, vous êtes obligé de proposer une solution simple et gratuite pour permettre à vos clients de résilier leur abonnement en ligne. Même si le contrat initial n’a pas été signé sur internet.
La fonctionnalité doit être facile à trouver depuis votre site ou votre application mobile. Elle doit être affichée sous une mention claire comme « résilier votre contrat ».
Elle doit aussi expliquer, de manière lisible, les conditions de résiliation : délai de préavis, frais éventuels, conséquences…etc.
Si vous n’offrez pas cette possibilité en ligne, vous risquez une amende de 15 000 € (personne physique) ou 75 000 € (personne morale).
Ce que le client doit pouvoir faire
La fonctionnalité doit permettre au client de renseigner ou de confirmer :
- son nom et prénom, ou la dénomination de l’entreprise s’il s’agit d’un professionnel
- son adresse mail ou postale
- la référence du contrat ou le numéro client
- la date souhaitée de fin de contrat
- pour les abonnements téléphoniques, le(s) numéro(s) concerné(s)
Une fois ces infos remplies, le client doit accéder à une page récapitulative où il peut vérifier ou modifier ce qu’il a saisi.
Si la résiliation est anticipée, un motif légitime peut être demandé. Dans ce cas, vous devez indiquer une adresse postale ou une adresse mail pour envoyer le justificatif. Il est aussi possible d’ajouter une option pour l’envoyer directement en ligne.
Exemple : une personne en situation de surendettement peut résilier son abonnement internet en vous transmettant la décision du juge.
Notification de la résiliation
Le client doit pouvoir confirmer la résiliation en cliquant sur un bouton clairement identifié, par exemple « notification de la résiliation ».
Une fois la demande reçue, vous devez envoyer une confirmation de réception. Vous devez aussi informer le client, dans un délai raisonnable, de la date de fin du contrat et des conséquences de la résiliation.
Important : vous ne pouvez pas obliger le client à créer un compte pour résilier. En revanche, s’il en a déjà un, vous pouvez lui demander de passer par cet espace.

